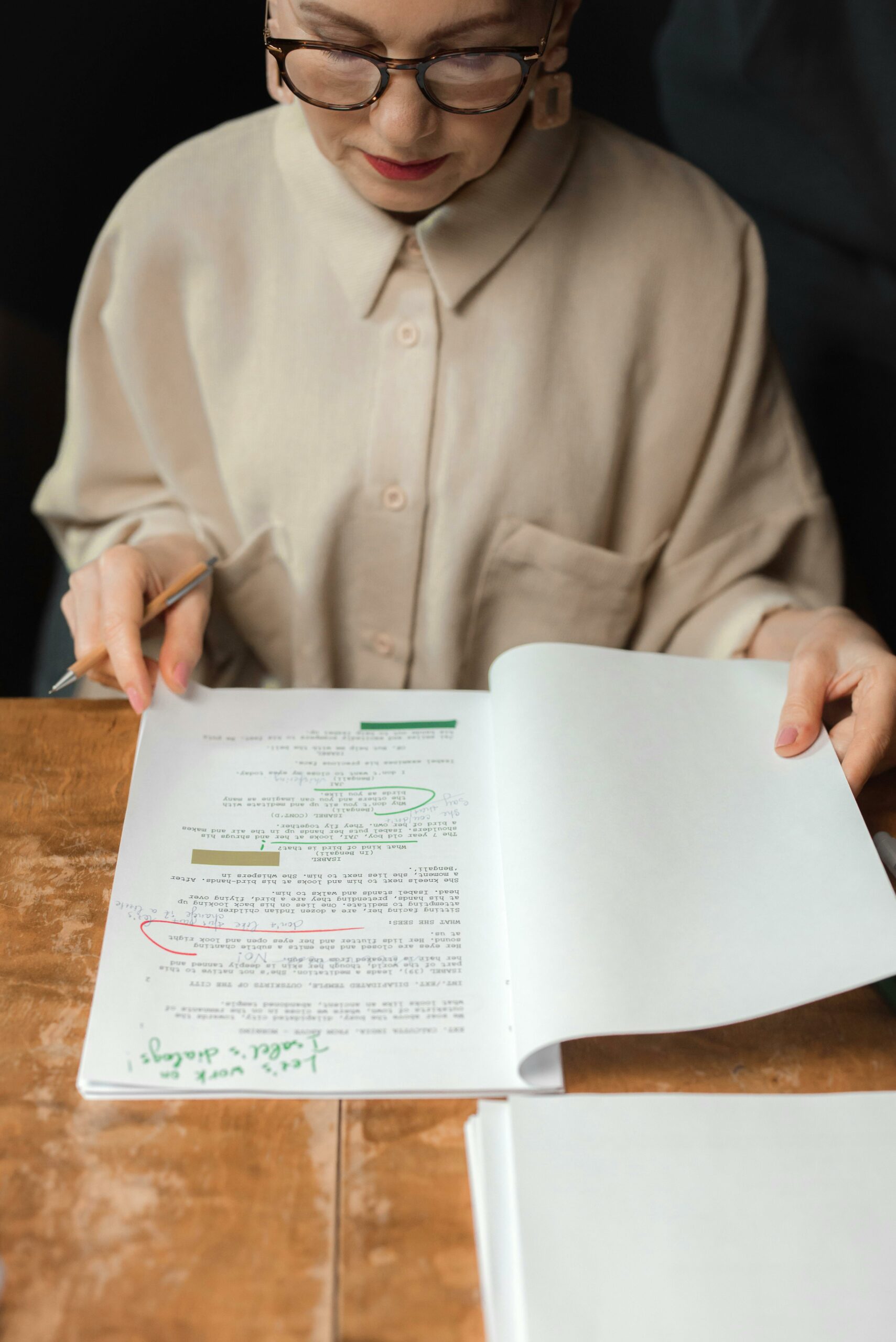S’il est relativement facile d’identifier comment les parlementaires européens et nationaux peuvent agir en faveur de la transition vers une recherche non-animale (propositions de lois ou de résolutions, amendements dans le cadre de projets de lois, questions écrites à la commission européenne ou au gouvernement), il est plus difficile d’identifier les leviers que peuvent actionner les élus locaux (régions, intercommunalités, communes).
- Les régions
La France compte 18 régions, 13 en France métropolitaine et 5 en outre-mer.
Le champ d’intervention des régions est très large.
Il concerne les transports interurbains, les lycées, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire et l’environnement, mais surtout le développement économique : notamment animation des pôles de compétitivité, mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II), définition des orientations en matière d’aides aux entreprises, etc., ainsi que la gestion des programmes européens notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui est un des fonds structurel de l’investissement européen.
L’un des moyens les plus efficace pour contribuer au niveau de la région à une transition vers une recherche non-animale est d’intégrer des orientations pouvant y contribuer dans le Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI).
Le SRESRI a plusieurs objectifs :
- Renforcer les interactions entre les universités, les laboratoires de recherche et les entreprises pour favoriser l’innovation et le transfert de technologies.
- Améliorer l’offre de formation en répondant aux besoins des entreprises locales et en favorisant l’accès à l’enseignement supérieur pour tous.
- Développer des infrastructures de recherche modernes et adaptées aux défis technologiques et scientifiques actuels.
- Encourager la mobilité des étudiants et des chercheurs au sein de la région et à l’international.
Chaque région adapte le SRESRI à ses spécificités et priorités locales, en concertation avec les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Pour en savoir plus : Code général des collectivités territoriales, articles L4251-1 à L4251-11.
Dès lors que le SRESRI est adopté par le Conseil régional, il faut envisager la seconde étape qui permettra de concrétiser ses orientations par des mesures concrètes. Il sera nécessaire d’élaborer des « règlements d’application » qui devront être validés par le Président du Conseil régional et les services administratifs compétents (l’avis du Conseil Economique Social et Environnemental Régional – CESER – pourra également être requis).
Ces règlements d’application peuvent inclure :
- Les conventions et partenariats : Entre les universités, les entreprises et les collectivités territoriales pour favoriser la recherche et l’innovation.
- Les appels à projets : Financés par les régions ou l’État pour soutenir des initiatives concrètes dans le cadre des orientations du SRESRI.
- Les plans de développement : Élaborés par les établissements d’enseignement supérieur pour aligner leurs actions avec les objectifs du SRESRI.
Ces différents moyens peuvent être mis en œuvre pour contribuer à valoriser et à développer les méthodes non-animales dans la recherche et l’enseignement supérieur et ce faisant renforcer le potentiel d’innovation et d’attractivité de la région.
- Les intercommunalités et les communes
Les intercommunalités sont des regroupements de communes qui peuvent prendre plusieurs formes : syndicats de communes, communautés de communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines, métropoles. Celles-ci ont des compétences plus ou moins étendues.
Cependant elles visent toutes à mieux coordonner les actions locales, mutualiser les ressources et renforcer la cohésion territoriale.
Par exemple, les métropoles – qui sont des structures intercommunales de grande envergure – ont des compétences qui se rapprochent de celles des régions. Elles peuvent (entre autres) prendre des décisions relatives au développement économique, social et culturel, à l’environnement et au cadre de vie, au développement urbain (dont les projets immobiliers), à l’éducation et à la formation (établissements scolaires et universitaires et formation professionnelle)…
Comment agir au niveau d’une métropole ?
Comme pour les régions, les métropoles élaborent des documents stratégiques : notamment le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui sont des documents de planification territoriale.
Appels à projets et subventions : Pour concrétiser les orientations stratégiques du SCOT, la métropole peut lancer des appels à projets et attribuer des subventions pour soutenir les initiatives locales qui s’inscrivent dans ces orientations.
Conventions et partenariats : La métropole peut signer des conventions de partenariat avec des universités, des entreprises et d’autres acteurs locaux pour réaliser des projets spécifiques en lien avec les orientations du SCOT.
Les élu(e)s métropolitain(e)s souhaitant œuvrer pour favoriser la transition vers une recherche non animale devront donc prévoir l’introduction dans le SCOT d’une mention indiquant la volonté de la métropole de soutenir le développement et la valorisation des méthodes de recherche et d’enseignement non-animales. Plusieurs moyens seront ensuite à la disposition du Conseil Métropolitain pour traduire cette orientation en mesures concrètes.
A contrario, le Conseil Métropolitain peut s’opposer à un projet de construction prévu sur l’une des communes de la métropole lors d’une délibération (élevage d’animaux destinés à la recherche, agrandissement d’une animalerie…) si celui-ci n’est pas compatible avec le PLUi et le SCOT ou pour d’autres motifs légitimes. Il peut demander au maire de la commune de retirer ou de modifier le permis de construire.
Comment agir au niveau d’une commune ?
- Avant l’octroi d’un permis de construire pour une animalerie ou un élevage d’animaux destinés à la recherche sur le territoire de la commune, s’assurer que toutes les garanties de sécurité ont été prises pour les populations et pour l’environnement. S’il s’agit d’animaux non-domestiques, des autorisations supplémentaires pourraient être nécessaires, à obtenir auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ou d’autres organismes compétents. Le respect des normes européennes en termes d’hébergement et de soins des animaux devra être vérifié, les risques de biosécurité évalués et la nécessité d’études d’impact complémentaires envisagée, en fonction des espèces considérées.
- Si des établissements élevant ou utilisant des animaux à des fins scientifiques sont déjà installés sur la commune, s’assurer du respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. Car les animaleries de recherche ne sont pas sans danger sur le plan sanitaire. Voir le document de l’INRS : « Risques biologiques en animaleries de recherche ».
- Le maire dispose de pouvoirs de police administrative, notamment en matière de salubrité publique et de sécurité. Il peut ordonner des contrôles et inspections pour s’assurer du respect des normes en vigueur.
- Les agents municipaux : Le maire peut faire appel aux agents municipaux (policiers municipaux, agents de salubrité, etc.) pour effectuer des contrôles sur le terrain.
- Les services de l’État : Le maire peut solliciter les services de l’État, tels que l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour les questions d’hygiène, ou la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour les questions de sécurité et de respect des normes environnementales.
- Les arrêtés municipaux : Le maire peut prendre des arrêtés municipaux pour imposer des mesures correctives si des non-conformités sont constatées lors des contrôles.
En cas de manquement aux réglementations, le maire peut prendre des mesures coercitives, telles que des mises en demeure, des sanctions administratives, ou même la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement en question.
- Autre action possible : favoriser les produits chimiques non testés sur animaux dans le cadre des marchés publics
Il est possible de faire figurer dans les appels d’offre concernant les produits utilisés par la commune – notamment les produits d’entretien – une condition spécifique : « non testés sur animaux ».
Plus les communes seront nombreuses à faire ce choix et plus nombreux seront les industriels à abandonner les tests sur animaux pour adopter d’autres méthodes.
La liste des actions possibles n’est pas exhaustive. D’autres opportunités peuvent être envisagées en fonction des contextes.
N’hésitez pas à contacter Transcience si vous souhaitez agir dans le cadre de votre collectivité.