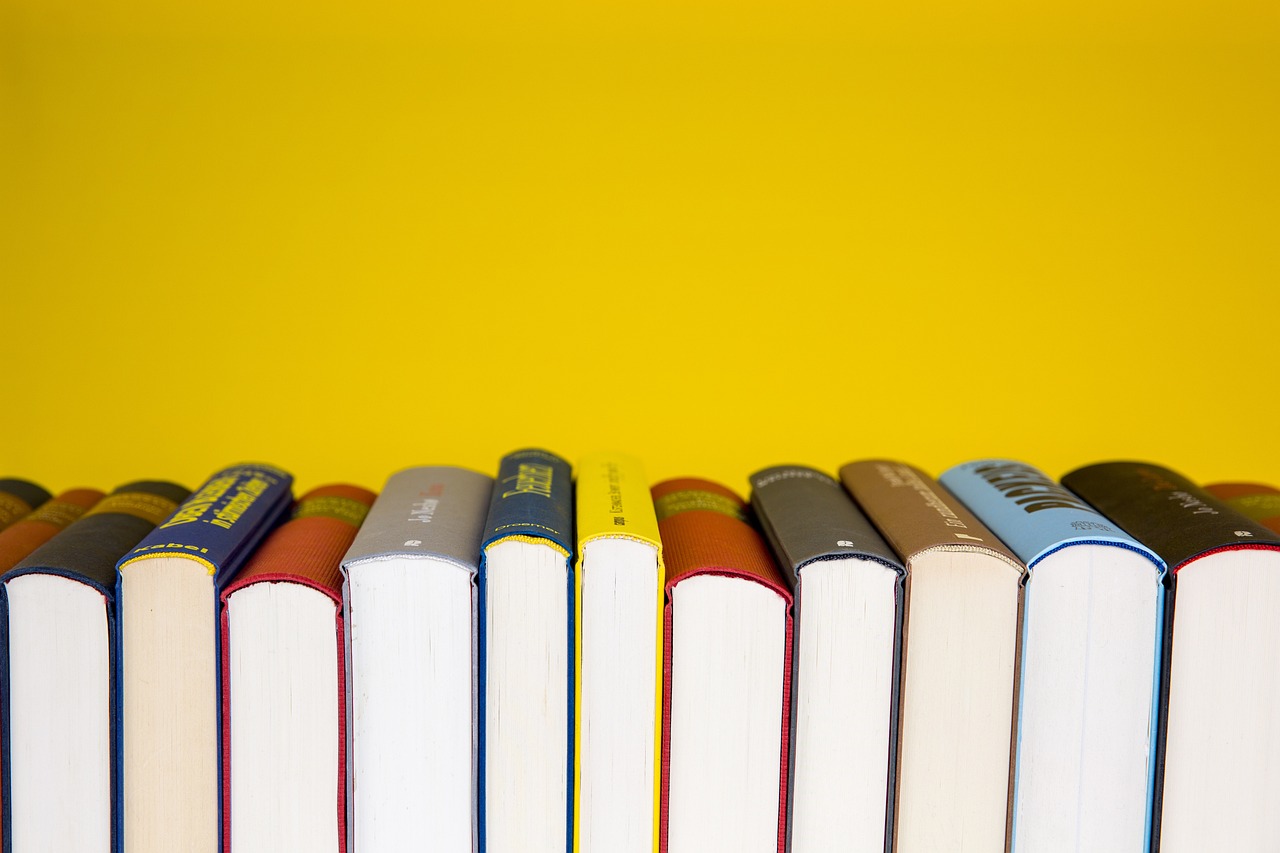La souffrance animale – Ethique et politiques de la condition animale, collectif, dir : F. Burgat, E. Dardenne, ISTE Editions, 2023
L’ouvrage collectif « La souffrance animale » porte sur la condition animale dans ses aspects les plus douloureux, en un sens le plus large possible. Cet ouvrage interdisciplinaire s’intéresse aux animaux placés sous la tutelle humaine, mais n’ignore pas la souffrance de ceux qui vivent libres. Il donne la priorité aux situations concrètes au cours desquelles les animaux endurent des souffrances sous l’emprise humaine : capture d’individus destinés aux parcs zoologiques européens, boucherie des chiens en Corée du Sud, élevages de cochons en Chine, expérimentation animale en Europe.
Cet ouvrage entend fournir une photographie la plus pertinente possible de la réification des animaux et de leur marchandisation pour penser ces phénomènes. La réflexion s’oriente également vers la quantification de l’altruisme envers les animaux, vers le problème moral des différents types de dommages qu’ils subissent, puis vers les points de vue des sciences vétérinaires, de la biologie et de l’éthique appliquées à propos de leurs émotions, de leur souffrance et de leur mort.
Le chapitre 5 (p. 99 à 124) intitulé « Prendre en compte la douleur des animaux soumis à des procédures expérimentales » a été rédigé par Muriel Obriet, présidente de Transcience.
Ce chapitre s’appuie sur les données chiffrées et sur l’approche réglementaire de la douleur des animaux soumis à des expériences en laboratoire pour décrire et analyser la nature des procédures auxquelles ils sont soumis. Il analyse le fonctionnement des instances évaluatrices, la pression des lobbies et les freins à la prise en compte des intérêts des animaux.
En français : La souffrance animale – ISTE Editions (istegroup.com)
En anglais : Animal Suffering | Wiley Online Books
La conscience des animaux : Expertise scientifique collective de l’INRA, réalisée à la demande de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire. Editions Quae, 2018
Coordination éditoriale : Pierre Le Neindre, Muriel Dunier, Raphaël Larrère, Patrick Prunet.
Cette expertise multidisciplinaire analysant un vaste corpus d’études comportementales, cognitives et neurobiologiques tend à montrer l’existence de contenus élaborés de conscience chez les espèces étudiées jusqu’à présent.
Pour en savoir plus : Cliquer ici
Douleur animale, douleur humaine. Données scientifiques, perspectives anthropologiques, questions éthiques, sous la direction de Jean-Luc Guichet, Ed. Quae, 2010, 216p.
Interroger l’une par l’autre douleur animale et douleur humaine brouille les distinctions ordinaires, animal et homme trouvant en cette épreuve partagée la marque sans doute la plus probante d’une proximité fondamentale. L’expérience montre par ailleurs qu’il est fort difficile pour l’homme livré à lui-même de comprendre un état dont, à nos dépens, nous éprouvons si souvent à la fois la puissance et l’opacité.
Certes, l’animal, faute de langage comparable au nôtre, ne peut nous déclarer et nous expliciter sa douleur – différence qu’il ne faut pas sous-estimer -, mais son comportement est cependant loin d’être silencieux à cet égard et nous en donne un témoignage précisément peut-être plus direct que celui, si contourné, des mots.
Dans cet ouvrage, des chercheurs de disciplines très diverses – biologistes, praticiens hospitaliers, éthologistes, vétérinaires, historiens, philosophes – s’appliquent, sur la base des données scientifiques, à faire le point sur la question de la douleur et des états associés chez l’animal et l’homme. Ressaisir cette question proprement vitale dans une perspective qui dépasse l’horizon strictement humain opère ainsi un rapprochement dont l’homme a tout à gagner, comme si le détour par l’animal lui permettait de diminuer la distance avec sa propre douleur en l’objectivant.
En retour, pour le scientifique, l’éleveur, le citoyen, pour tout homme simplement, la reconnaissance de la douleur animale contribue à clarifier les bases éthiques d’un débat de plus en plus actuel et pressant qui ne peut être indéfiniment différé.