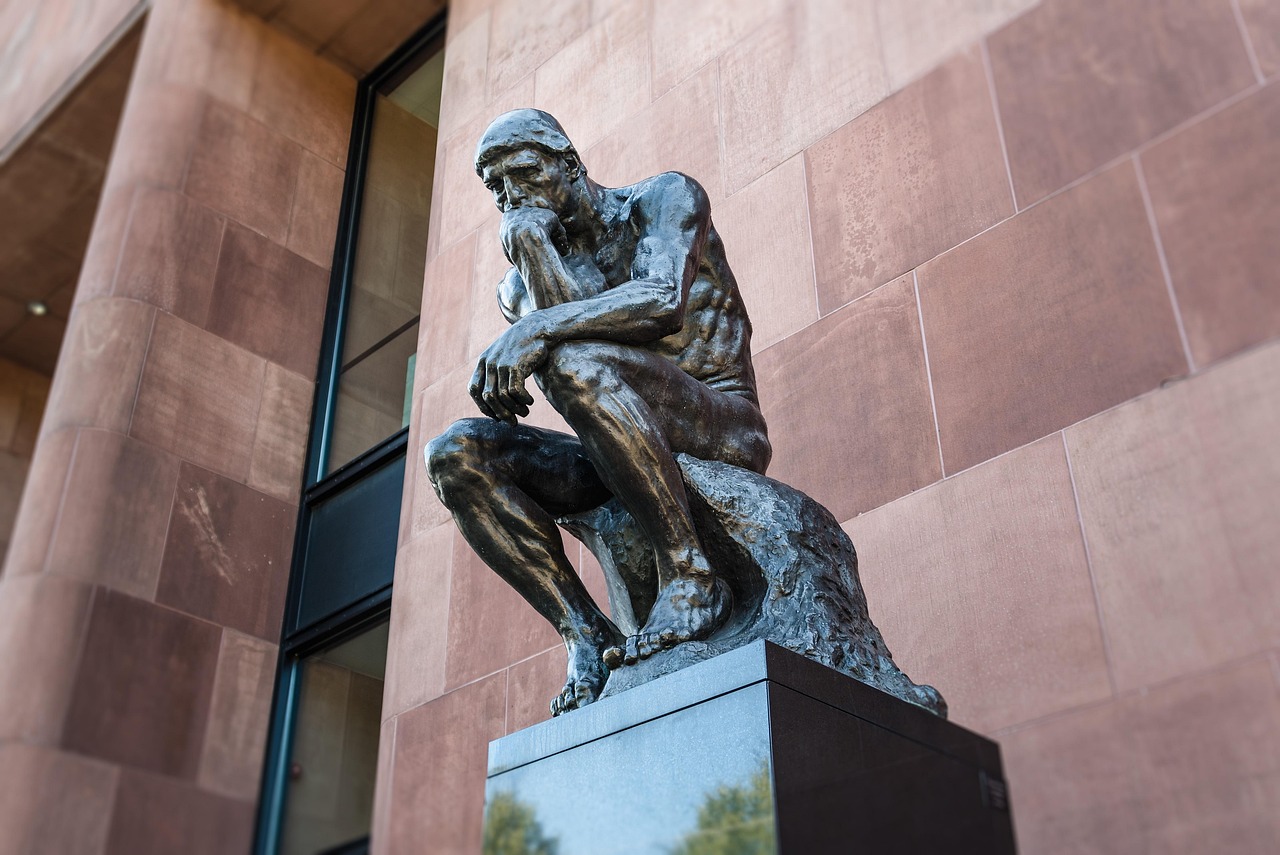Le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale (CNREEA) est un comité consultatif créé en 2005. Son fonctionnement et ses missions sont définis par les articles R.214-134 à 136 du Code rural et de la pêche maritime. Placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (CNPAfis/ex CNEA), il a pour mission d’émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l’expérimentation animale.
Le comité est composé d’un président et de 12 membres (et autant de suppléants) nommés par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : quatre professionnels de l’expérimentation animale choisis dans le secteur public, deux autres professionnels de l’expérimentation animale proposés par des organisations représentatives du secteur industriel privé, trois membres des sciences humaines (philosophe, juriste, sociologue), et trois personnalités désignées sur proposition d’organisations reconnues d’utilité publique de protection des animaux et de la faune sauvage.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il faut préciser que ce comité national a été en sommeil jusqu’en 2020. Il n’y a d’ailleurs aucun compte-rendu ou bilan d’activité avant cette année-là.
Composition actuelle du CNREEA : Arrêté du 8 novembre 2024 portant nomination au Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale – Légifrance
Les missions du CNREEA consistent notamment à :
- Élaborer, publier et actualiser s’il en est besoin une charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale et faire toute proposition sur sa mise en application (deux versions de la charte ont été publiées jusqu’à présent, une en 2008 et la seconde en 2014).
- Conduire l’élaboration et la mise à jour d’un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d’éthique en expérimentation animale.
- Établir le bilan annuel national d’activité des comités d’éthique et formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques.
- Adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d’améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
L’une des principales missions du CNREEA reste la production du bilan annuel des comités d’éthique en expérimentation animale (CEEA). Seuls les bilans des années 2021, 2022 et 2023 sont accessibles (comme indiqué plus haut, le comité était quasi inactif entre 2005 et 2020).
Accès aux bilans des CEEA :
Par ailleurs, le CNREEA produit régulièrement depuis 2020 des recommandations destinées à la CNPAfis. Celles-ci sont accessibles sur le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (ainsi que les relevés de décisions des réunions) : cliquer ici
Accès à quelques-unes de ces recommandations :
– Avis sur l’appréciation rétrospective des projets impliquant des animaux à des fins scientifiques
– Avis sur l’évaluation des projets impliquant des animaux à des fins scientifiques
LE CONSTAT
On ne peut que se réjouir de la reprise d’activité du CNREEA en 2020. Celle-ci pouvant tout autant être imputée à la volonté du nouveau président de cet organisme de « faire bouger les choses » qu’aux effets des premières actions en justice d’associations – dont Transcience – devant la juridiction administrative contre l’inaction et le manque de transparence du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Si les bilans des comités apportent quelques informations intéressantes sur l’hétérogénéité de leur fonctionnement et de leurs moyens ainsi que sur d’évidents problèmes d’indépendance pour un certain nombre d’entre eux, beaucoup d’informations font défaut. Le formulaire d’enquête devrait prévoir davantage de questions ouvertes qui permettent une expression plus libre mais surtout inclure de nouvelles questions relatives aux méthodes de remplacement (compétences au sein du comité, recours à des experts, formations spécifiques sur ces méthodes, etc.).
Les recommandations adressées à la CNPAfis sont toujours exprimées avec beaucoup de modération. On perçoit la volonté de créer un consensus lequel se fait toujours au détriment de l’intérêt des animaux.
Quant à l’élaboration et la mise à jour des guides destinés aux membres des comités d’éthique (guide des règles communes d’organisation et de fonctionnement et guide de l’évaluation éthique des projets), elles ont été confiées à un groupe de travail du Gircor (organisation de lobbying pro expérimentation animale) à la demande du ministère de la recherche lui-même. Le CNREEA n’étant là que pour formuler des recommandations…
De facto les missions du CNREEA telles que définies dans la réglementation n’ouvrent pas la voie à un vrai débat d’idées sur les questions éthiques soulevées par l’expérimentation animale. D’ailleurs la composition actuelle de cette organisation qui fait la part belle aux professionnels de l’expérimentation animale – lesquels représentent la moitié des membres – traduit bien la volonté des pouvoirs publics non pas d’interroger cette pratique sur le plan éthique mais uniquement d’apporter des améliorations à la marge.
Pour que le CNREEA puisse mener une réelle réflexion éthique (comme le laisse supposer son intitulé) et faire des recommandations disruptives aux pouvoirs publics, la composition devrait en être repensée.
Pour que puissent être posées des questions de fond telle que celle de la réification des animaux utilisés à des fins scientifiques et éducatives, êtres vivants sensibles réduits au statut de « matériel de recherche » ou « d’organismes vivants », le CNREEA devrait notamment être composé de spécialistes en éthique animale et en psychologie sociale, de vétérinaires algologues, d’éthologues, de représentants de la société civile et d’associations de patients ainsi que de chercheurs ayant développé des méthodes non-animales.
Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous conseillons de vous reporter à cette page du site « expérimentation-animale.info » : Contenus recommandés sur l’expérimentation animale.