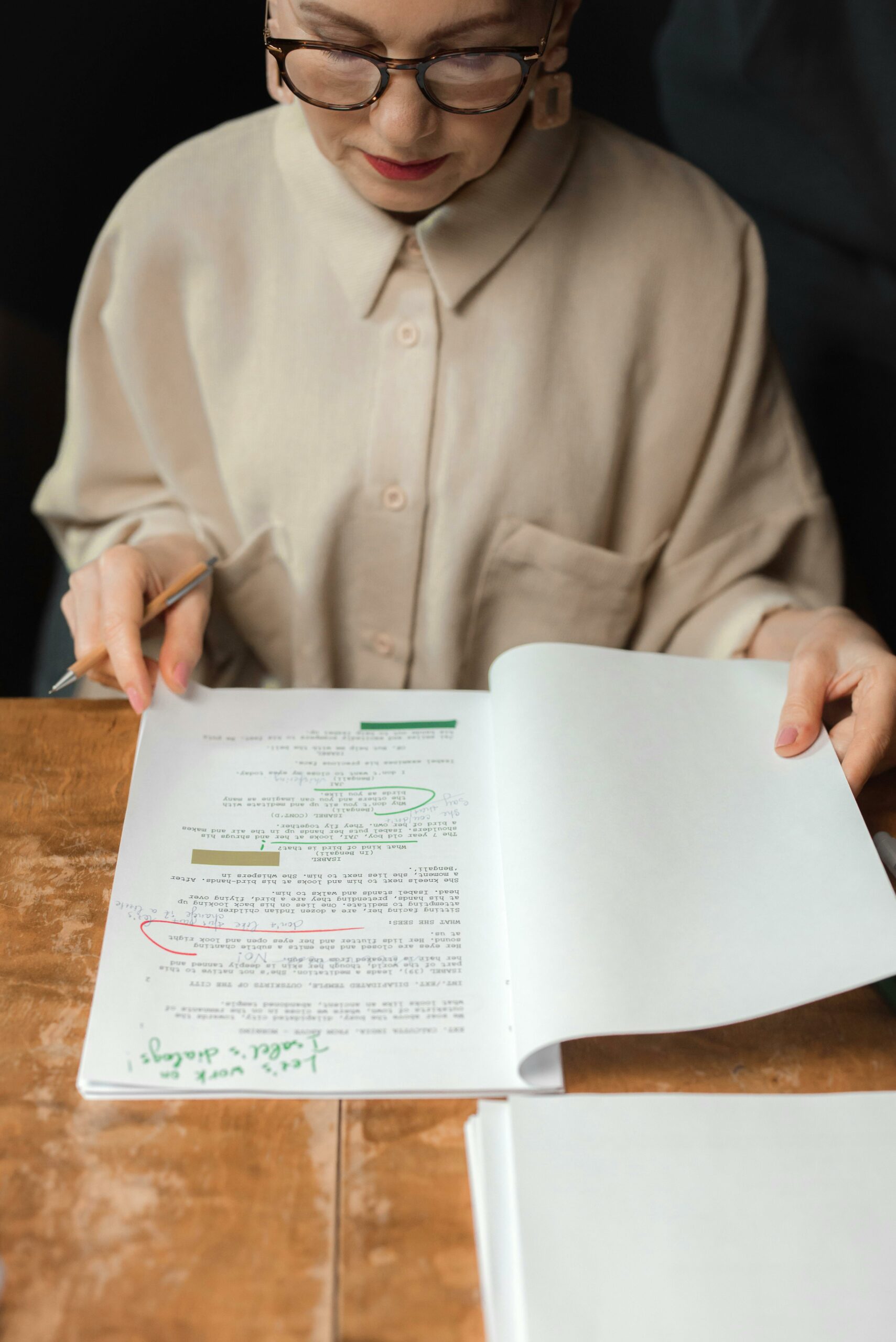Dans le cadre du plan France 2030 en faveur des investissements innovants, une Agence de l’innovation en santé a été créée, au sein du Secrétariat général à l’Investissement, officiellement le 31 octobre 2022. Cette Agence est chargée de piloter le plan Investissement Santé 2030, de coordonner les travaux en matière de prospective en santé, avec 4 priorités stratégiques :
- numérique en santé,
- biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes,
- maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC,
- dispositifs médicaux innovants.
D’autres domaines sont aussi soutenus comme la santé des femmes et des couples, la psychiatrie, le stockage de données sur l’ADN ou dérivés…
Sur plus de 7,5 Md€ consacrés aux projets innovants en santé, 1,7 Md€ sont dédiés à la recherche biomédicale : 1 Md€ pour renforcer notre capacité de recherche biomédicale, en soutenant notamment la création de centres d’excellence et de bioclusters de dimension mondiale (en 2023 : création de 12 nouveaux Instituts hospitalo-universitaires (IHU) et 4 nouveaux bioclusters), en soutenant des infrastructures essentielles en biologie et santé ; 550 M€ consacrés à la recherche dans le cadre des 4 priorités stratégiques ; 110 M€ dédiés à des programmes de recherche exploratoires.
Dans ce cadre, sont soutenus des programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR), dont le projet MED-OOC, programme de recherche exploratoire co-dirigé par le CEA, le CNRS et l’Inserm, visant à développer des organes et organoïdes sur puce pour la médecine personnalisée, avec un budget de 48,5 millions d’euros sur six ans.
Dans la feuille de route 2023-2025 publiée fin novembre 2023, à signaler le lancement en 2024 d’une étude prospective sur les organes sur puces :
- « À l’intersection des domaines de l’ingénierie cellulaire et tissulaire et de la microfluidique, les organes sur puces sont des dispositifs miniaturisés intégrant des cellules pour reproduire les caractéristiques architecturales, dynamiques et fonctionnelles d’un organe, voire de plusieurs organes interconnectés. Ils servent à étudier le développement et le fonctionnement des organes, ainsi qu’à tester de nouveaux médicaments et traitements. Ils peuvent être particulièrement utiles pour faciliter les étapes de recherche pré-clinique in vitro et réduire les besoins en expérimentation animale. On observe en Europe une augmentation des initiatives académiques et industrielles dans ce domaine. La France, en particulier, bénéficie d’un écosystème de recherche de pointe en biotechnologie, ainsi qu’une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la microfluidique. Notre objectif est d’évaluer l’importance potentielle de cette approche dans le développement des biomédicaments, son acceptabilité par les acteurs industriels, et d’anticiper les enjeux réglementaires afin d’être force de proposition pour la mise en place notamment de normes de certification. » Il s’agit d’évaluer leur impact en termes de coût, efficacité, rapidité.
Les soutiens aux méthodes non-animales telles que les organes sur puces et les organoïdes figurent dans la priorité stratégique « biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes » (priorité qui regroupe au total 800 millions €), avec 4 volets : recherche, transfert-valorisation, industrialisation, formation, afin de développer complètement ces filières jusqu’aux patients. Les perspectives (non immédiates) sont de développer, avec ces technologies, la bioproduction de biomédicaments (médecine de précision), et d’une manière générale d’améliorer l’efficacité de la recherche pré-clinique et de fait, diminuer l’utilisation d’animaux lors de cette phase (ce qui serait déjà possible en supprimant les expériences peu utiles ou les mauvais modèles).
Il y a déjà eu des actions de soutien, via des appels à projets (opérés par l’Agence Nationale de la Recherche pour le secteur public, par la Banque Publique d’Investissement pour le secteur privé, via des subventions ou des avances remboursables), concernant dans l’industrie aussi bien des start-ups que des grands groupes.
Exemples d’appels à projets : innovations en biothérapie et bioproduction, nouveaux procédés de développement de biothérapies.
Une RHU (recherche hospitalo-universitaire en santé) a été soutenue à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif (responsable : Fanny Jaulin) en 2021 : ORGANOMIC (Organoïdes dérivés de patients pour une médecine personnalisée de type fonctionnelle), avec une aide de 9 millions €.
Le contrat du comité stratégique de la filière (CSF) industries et technologies de santé 2023-2026 a été signé le 27 novembre 2023, sous l’égide du Ministère de l’Economie/Conseil national de l’Industrie (la Présidente, Audrey Derveloy, est la présidente de Sanofi France), associé au ministère de la Santé et au ministère de la Recherche. Il comprend plusieurs axes, dont :
- Axe B : Compétitivité, attractivité et souveraineté : Projet 6 : Favoriser le financement de start-ups dans la santé et les capacités de bioproduction
- Axe D : Création d’un système d’innovation dynamique : Projet 14 : Dynamiser et structurer les acteurs de la recherche pré-clinique et clinique en France
On peut notamment lire dans l’argumentaire de ce projet 14 :
- Actuellement encore un nombre important d’essais cliniques échoue (environ 90%), même lorsque les études précliniques ont apparemment démontré l’efficacité et l’innocuité d’une substance donnée. Les complications et les inefficacités des études précliniques peuvent entraîner des retards coûteux ; on estime en effet que 75% du coût de développement d’un nouveau médicament est dû à ces abandons.
L’augmentation de la représentativité des recherches précliniques par rapport à la réalité clinique apparait comme une priorité ; à titre d’exemple nous pouvons citer l’amélioration de modèles, le développement de nouvelles technologies précliniques en termes de mesure d’efficacité ou de toxicité plus prédictive des effets chez le patient, …
Dans ces conditions, cette étape de la recherche est l’objet de nombreuses réflexions afin d’en optimiser l’efficience et la précision. Les réflexions actuelles sont en pleine expansion pour apporter plus de prédictibilité aux essais précliniques, plus de fluidité dans les travaux et globalement plus de robustesse à la recherche préclinique.
Par ailleurs, les attentes sociétales et le renforcement des exigences européennes sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques accélèrent la démarche des 3R (Replace, Reduce, Refine). Dans cette perspective, le développement de méthodologies et d’approches alternatives visant à réduire, voire remplacer, le recours à des modèles animaux offrent de nombreuses opportunités. Outre la problématique éthique associée à l’usage et au bien-être animal que ces approches permettent d’adresser, elles contribuent également à développer des méthodologies permettant l’obtention de données plus représentatives de la biologie humaine. Pour ce faire, il faudrait dès à présent accélérer et accompagner la transition à la fois sur les plans technologiques, réglementaires et en termes de validation et de recevabilité. Afin de répondre aux enjeux sur la fluidité des processus et la mise en place d’un environnement favorable au développement et à l’accueil de nouveaux projets de recherche préclinique, le projet du Contrat Stratégique de filière des industries et technologies de santé axera ses travaux sur 3 thématiques :
- Les biobanques
- Les nouveaux modèles in vitro (organoïdes, systèmes microphysiologiques, modèles in silico, organes-sur-puce, usages des biopsies, cellules souches in vitro, …)
- L’importation / exportation d’échantillon d’origine humaine
…
La compétition pour la maitrise, l’accès et la diffusion de ces technologies ou organisations est forte et les pays qui auront su être précurseurs en favorisant l’établissement d’une communauté dynamique et d’un écosystème porteur auront un avantage significatif sur la compétitivité d’un secteur stratégique. Cela permettra aussi d’assurer à ces pays leur souveraineté qui parait absolument essentielle en 2023, dans ce secteur.
…
Il s’agit dans ce projet de mobiliser tous les acteurs français, privés et académiques, pour devenir leader en Europe en créant et structurant une filière et d’être proactif sur les évolutions de l’environnement réglementaire afin de faciliter le recours à ces nouveaux outils pour susciter l’intérêt des industriels et élargir leur diffusion.
Il est important de structurer rapidement les acteurs du biobanquing et des organes sur puce car la France dispose d’un écosystème de recherche de pointe, avec de nombreux laboratoires et centres de recherche de renommée internationale. Cela aiderait à développer une industrie en pleine expansion, à renforcer les liens entre la recherche et l’industrie, à coordonner les initiatives de recherche et de développement, à renforcer la visibilité internationale de la recherche et des industries françaises dans ce domaine et surtout à renforcer la souveraineté de notre nation dans ce domaine clef.
Ce projet doit engager des travaux sur les trois thématiques, et ainsi :
- produire des recommandations sur la mise en place d’une gouvernance nationale des biobanques, proposer des évolutions réglementaires pour faciliter l’accès aux échantillons ;
- structurer la filière organes sur puces en France, compléter l’identification et la cartographie des acteurs et des domaines d’expertise et établir un réseau de communication, établir une feuille de route de projets pilotes, établir un contrat cadre avec l’ANSM et/ou l’EMA pour les inciter à co-construire avec l’association un processus de soumission règlementaire (dans l’objectif de permettre de soumettre des dossiers incluant des tests non-animaux), construire des programmes de formation pour les étudiants et chercheurs, etc. ;
- établir des recommandations sur l’organisation et la réglementation relative à l’importation/exportation des échantillons biologiques d’origine humaine.