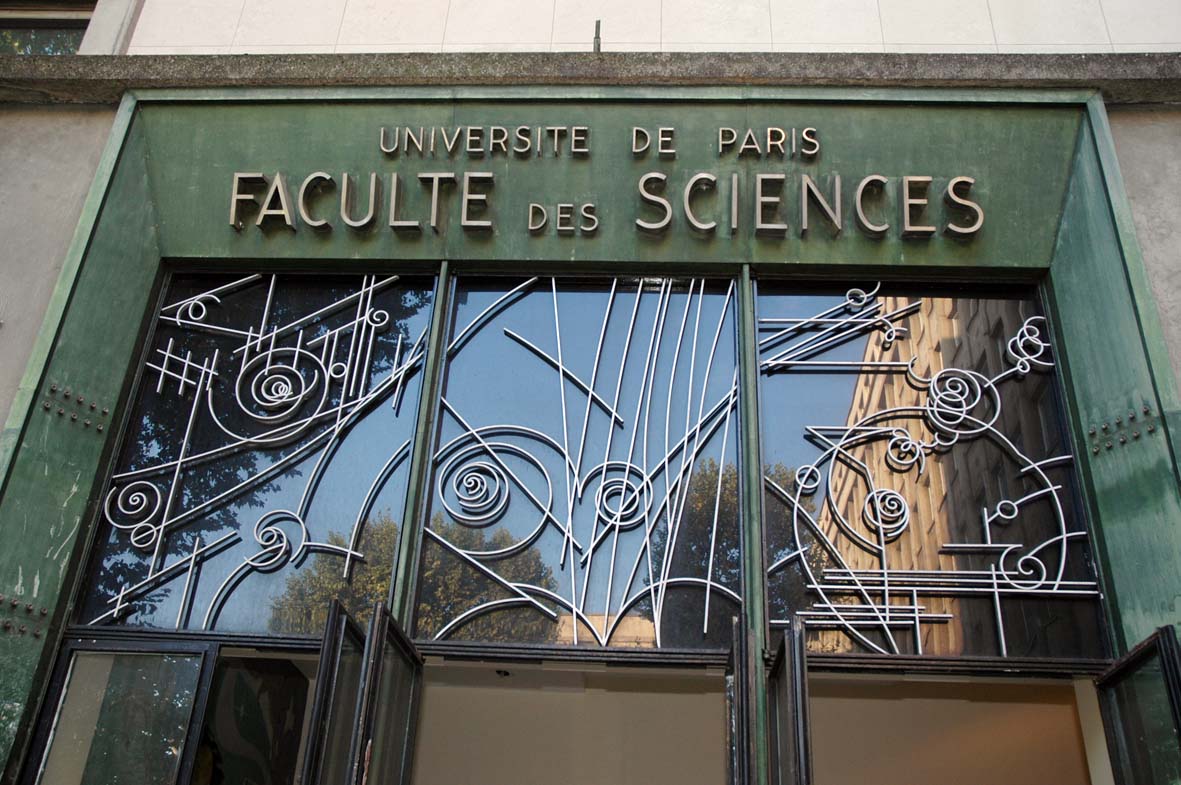Au moins deux facteurs devraient contribuer à la réduction du nombre d’expériences pratiquées sur les animaux dans le cadre de projets scientifiques ou éducatifs : une réglementation plus exigeante depuis la transposition en droit français de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et le développement remarquable des approches et méthodes non animales – souvent nommées NAMs (New Approach Methodologies) – ces dix dernières années.
Accès aux statistiques annuelles depuis 2014 en France, site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : cliquer ici
Accès à notre analyse détaillée de l’évolution des données chiffrées entre 2015 et 2023 : cliquer ici
Historique et décryptage
Jusqu’en 2010, les animaux comptabilisés lors du recueil des données statistiques annuelles dans les différents Etats membres de l’Union européenne avaient tous été utilisés dans des procédures expérimentales.
Pour faire suite à l’adoption de la directive européenne 2010/63/UE et pour préparer une collecte harmonisée des données par tous les Etats membres, la décision d’exécution 2012/707/UE introduit une mention spécifique pour les animaux génétiquement modifiés n’ayant pas été utilisés dans les procédures expérimentales : ceux utilisés pour la création d’une nouvelle lignée (animaux porteurs de la modification génétique) ou pour la maintenance d’une lignée établie présentant un phénotype dommageable[i] sont comptabilisés à partir de 2014.
Une seconde décision d’exécution est prise par la Commission européenne en 2020, la décision (UE) 2020/569, qui précise que les statistiques annuelles doivent inclure les animaux génotypés[ii] au moyen de méthodes invasives (biopsies de queue ou d’oreille, phalangectomie…). Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis 2022 en France.
Cette évolution de la comptabilisation des animaux depuis 2010 a permis que les tous les animaux dont l’utilisation à des fins scientifiques est susceptible de leur causer « une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires » (article 3 de la directive : définition d’une « procédure ») soient pris en compte dans les statistiques.
Nous disposons donc depuis 2015 de données globalement assez fiables même si les récentes modifications apportées dans la manière de comptabiliser les animaux rendent parfois difficiles les comparaisons d’une année sur l’autre, d’autant que les consignes ne sont pas toujours bien comprises par les acteurs de terrain et que des erreurs peuvent être commises dans le recueil des données.
Une tendance se dégage-t-elle entre 2015 et 2023 ?
Il est difficile de dégager une tendance globale. A la fois parce qu’il peut y avoir des fluctuations importantes d’une année sur l’autre – dont on ne détermine pas toujours la cause – et parce que les évolutions sont sensiblement différentes d’un objet d’utilisation à l’autre et qu’il faudrait donc parler de tendances au pluriel.
Entre 2015 et 2021 (avant que ne soient intégrés les animaux génétiquement modifiés ayant subi un génotypage invasif et non inclus dans une procédure), le nombre total d’animaux est resté quasiment stable puisque l’on est passé de 1 901 752 animaux en 2015 à 1 893 897 en 2021, à l’exception de la chute de 2020. Celle-ci s’explique par l’interruption de nombreux projets pour cause de confinement et non par une soudaine réorientation de la recherche vers des méthodes alternatives.
Des années de transition : 2022 et 2023
En 2022, l’intégration des animaux subissant un génotypage invasif fait partir les chiffres à la hausse pour atteindre un total de 2 128 058 animaux contre 1 893 897 en 2021.
En 2023, on constate une légère inflexion (-3,8%) avec 2 046 754 animaux.
Mais celle-ci ne doit pas masquer le fait que le nombre d’animaux génétiquement modifiés destinés à la maintenance des lignées ait augmenté de 118%, passant de 225 435 en 2022 à 491 778 en 2023 ! Sans que l’on puisse l’expliquer. Ils n’étaient que 69 561 en 2021 avec le précédent mode de comptabilisation.
A contrario, on constate une diminution spectaculaire du nombre d’animaux utilisés dans le domaine de la recherche fondamentale (206 097 animaux en moins) et dans une moindre mesure dans le domaine de la recherche translationnelle (94 974 animaux en moins). Dans la mesure où aucune explication ne peut être confirmée quant à cette soudaine et importante réduction, il n’est pas possible de savoir s’il s’agit de l’amorce d’une tendance baissière, d’un simple phénomène conjoncturel ou d’un problème dans l’affectation des animaux aux catégories d’objectifs.
Des tendances se dégagent-elles sur la période pour certains objets d’utilisations ?
Les utilisations cumulées pour la recherche (fondamentale et appliquée) sont restées stables sur la période 2015/2023 (environ 1,2 million d’animaux) avec cependant d’importantes fluctuations à la baisse entre 2019 et 2020 (effet Covid) et entre 2022 et 2023 (la cause n’est pas identifiée).
Les utilisations pour les tests réglementaires, les contrôles de qualité des lots et productions de routine de produits biologiques (anticorps, produits sanguins…) se retrouvent regroupées dans une même catégorie dans les tableaux publiés par le ministère.
Il convient cependant de subdiviser celle-ci en deux catégories distinctes pour lesquelles la tendance est opposée. En effet, on constate une baisse régulière du nombre d’utilisations pour les tests réglementaires et contrôles de qualité qui peut s’expliquer par les différentes initiatives de l’Union européenne en la matière depuis plusieurs années (notamment la feuille de route pour la sortie de l’expérimentation animale pour les tests de sécurité des produits chimiques) fortement soutenues par des ONG « parties prenantes ». A contrario, le nombre d’animaux utilisés pour les productions de produits biologiques n’a cessé d’augmenter dans une proportion équivalente à la réduction des utilisations dans le domaine réglementaire. Les courbes se sont croisées en 2021. Cette augmentation constante pourrait s’expliquer par une demande sans cesse croissante d’anticorps utilisés pour le diagnostic médical et certaines thérapeutiques. La France reste le seul pays européen à produire des anticorps monoclonaux en utilisant la méthode très douloureuse de l’ascite sur des souris.
Quant aux utilisations à des fins d’enseignement et de formation, non seulement elles sont bien supérieures en 2023 à ce qu’elles étaient en 2015 (28 271 en 2015 contre 35 738 en 2023) mais elles sont également bien supérieures à celles de tous nos voisins européens à l’exception de l’Allemagne.
Cette situation est choquante car de nombreux outils pédagogiques alternatifs existent. La plupart des projets « éducatifs » utilisant des animaux ne devraient pas être autorisés par les autorités administratives car il existe des méthodes de remplacement.
La force des conditionnements et des a priori des enseignants et formateurs, leur manque de connaissance de la diversité des outils existants, l’absence d’investissements des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de formation pour l’achat et le développement de nouveaux outils et méthodes d’apprentissage, expliquent en grande partie cette situation.
La Commission Nationale pour la Protection des Animaux à des fins scientifiques (CNPAfis) – dans le cadre de sa mission d’évaluation des formations professionnelles destinées aux utilisateurs d’animaux et en tant que force de proposition auprès du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – devrait réaliser un inventaire des méthodes pédagogiques non animales et contribuer à leur promotion. Jusqu’à présent, elle ne le fait pas.
Le nombre d’utilisations pour les objets « préservation des espèces » et « protection de l’environnement » a considérablement augmenté ces dernières années. Il serait intéressant de connaître la finalité des projets qui ont justifié ces utilisations.
Tous les animaux utilisés à des fins scientifiques sont-ils représentés dans les statistiques annuelles ?
Non, seuls sont comptabilisés les animaux vertébrés et les céphalopodes qui ont été utilisés dans une procédure expérimentale ainsi que les animaux entrant dans les catégories ajoutées par les décisions d’exécution de la Commission européenne de 2012 et de 2020 (voir plus haut). Mais beaucoup d’autres animaux sont élevés et tués pour des finalités scientifiques, bien que n’ayant pas été intégrés dans un projet de recherche ou un projet éducatif : les animaux génétiquement modifiés ne souffrant pas d’un phénotype dommageable, n’ayant pas subi un génotypage invasif mais n’ayant pas développé les caractéristiques attendues, ceux dont on prélève les organes et les tissus, ceux qui sont trop âgés ou malades… Depuis 2017, ces millions d’animaux sont pris en compte dans l’enquête quinquennale de l’Union européenne.
En France, le nombre de ces animaux s’élevait en 2022 à 2,77 millions.
Par conséquent, toutes catégories réunies, le nombre d’animaux utilisés à des fins scientifiques chaque année en France peut être estimé entre 4,8 et 5 millions.
En conclusion, à l’exception de l’évolution satisfaisante dans le domaine des tests réglementaires – que l’on doit aux instances de l’Union européenne – aucune réduction significative ne se dessine dans les autres domaines qui utilisent des animaux à des fins scientifiques.
Ce constat est extrêmement décevant, dix années après la mise en œuvre de la directive européenne 2010/63/UE. Il traduit tout autant le manque de volonté politique d’accompagner la transition que le conservatisme et la frilosité du monde de la recherche biomédicale dans notre pays.
[i] Phénotype dommageable : caractère ou effet indésirable résultant d’une modification génétique susceptible d’entraîner des effets négatifs ou nuisibles pour l’animal
[ii] Génotypage : méthode d’acquisition de données permettant de déterminer l’identité d’une variation génétique. Il consiste en l’analyse d’ADN prélevé à partir de tissus ou de fluides corporels par des moyens non invasifs ou invasifs.