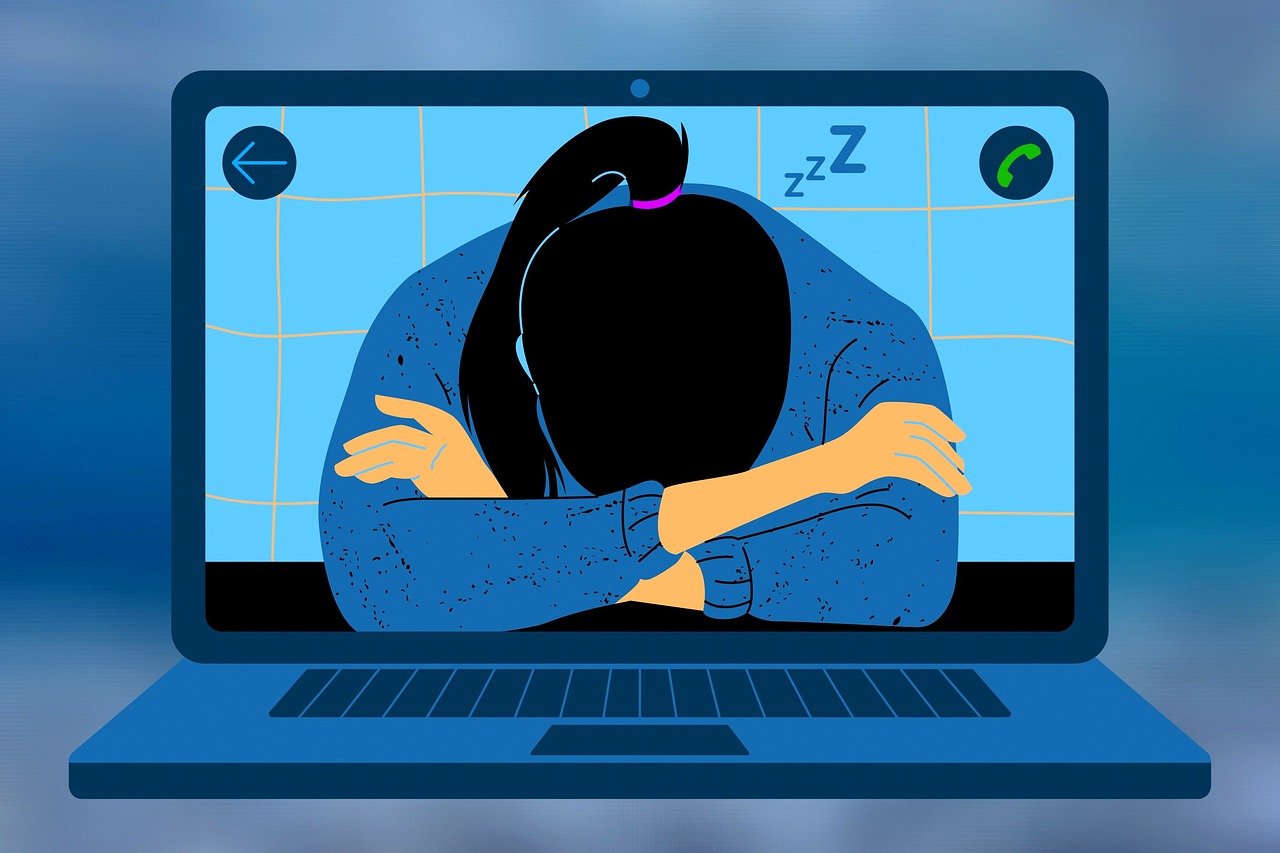Le 5 février 2020, la Commission européenne a publié un rapport relatif aux données statistiques sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques par les 28 Etats membres de l’Union européenne au cours des années 2015 à 2017 (cliquer ici) et un rapport sur la mise en oeuvre de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (cliquer ici).
Ces rapports ont été élaborés sur la base des données communiquées par les Etats membres. Toutefois, les données statistiques annuelles adressées par les Etats membres à la Commission ne prennent en compte que les animaux vertébrés et à la condition qu’ils aient été inclus dans une « procédure » (c’est-à-dire une utilisation à des fins expérimentales). Les rapports annuels incluent les animaux utilisés pour la création et l’entretien de lignées génétiquement modifiées.
La Directive prévoit aussi que les Etats membres doivent produire tous les cinq ans des données concernant les animaux tués sans avoir été utilisés à des fins expérimentales. Le premier Rapport quinquennal depuis l’entrée en vigueur de la Directive en 2010 relatif à l’année 2017 a également été publié le 5 février 2020.
Nos principales conclusions :
L’application plus ou moins stricte et cohérente de la Directive n’est que la traduction des lacunes et des brèches de celle-ci : des définitions pas assez explicites, des dispositions trop peu contraignantes car les Etats membres disposent d’une très grande marge d’appréciation, des possibilités de dérogations trop nombreuses et une liberté bien trop grande laissée à chaque Etat membre pour sa mise en oeuvre.
Par ailleurs, l’attitude extrêmement compréhensive de la Commission européenne vis-à-vis des Etats membres retardataires voire contrevenants à certaines dispositions prévues par la Directive, contribue encore davantage à en limiter la portée et à en ralentir les effets. Les procédures d’infraction devraient être lancées de manière beaucoup plus rapide et systématique.
On peut déplorer que depuis 2013 la Commission européenne n’ait pas su témoigner d’un réel volontarisme par la mise en place un accompagnement efficace des Etats membres dans la transformation de leurs pratiques, notamment en ce qui concerne le développement et la valorisation des méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
Le modèle animal reste « le » modèle pour la plupart des chercheurs.
Si la Commission européenne ne pose pas des actes forts vis-à-vis des Etats membres pour le développement, la valorisation et l’utilisation des méthodes non-animales, non seulement l’objectif final du remplacement total des animaux (cf. considérant 10 de la Directive) restera à jamais inaccessible mais il ne serait pas impossible que le nombre d’animaux élevés et tués à des fins scientifiques reparte à la hausse.
Pour accéder à l’analyse complète de Transcience : Cliquer ici